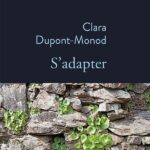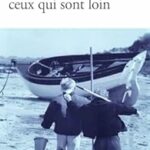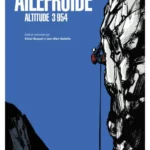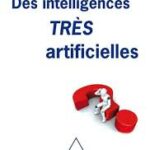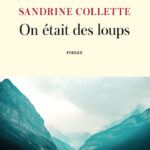Alma Revel, quarante-neuf ans, coordonne le pôle d’instruction antiterroriste depuis 2012. Avec onze autres magistrats, elle dirige les enquêtes, interroge les suspects, reçoit les familles de victimes. Le but : exposer les faits, établir les charges. L’histoire s’inscrit dans le contexte de cette France durement frappée par une vague d’attentats islamistes, où pour les juges, les cas de conscience se multiplient. La Décision, c’est le récit de l’un de ces dilemmes lourds de conséquences.
Un dilemme éthique
Fin 2014, Abdeljalil Kacem quitte en secret la France avec sa toute nouvelle épouse, Sonia, pour se rendre en Syrie, avant d’en revenir quelques mois plus tard. À leur retour, le couple est intercepté. Depuis les attentats qui ont secoué le pays en 2015, c’est la procédure : ceux qui partent Syrie sont mis en examen à leur retour pour examiner leurs intentions et leur degré de dangerosité. La question est la suivante : Abdeljalil Kacem et son épouse ont-ils prêté allégeance à l’État islamique ? Représentent-ils une menace pour l’intégrité de la nation ?
C’est à Alma qu’incombe la responsabilité d’instruire le dossier et de déterminer si A. Kacem est revenu pour commettre un attentat ou si, au contraire, il est sincère dans le repentir qu’il exprime. La position est délicate, car dans les faits, le jeune homme ne semble pour l’heure coupable de rien d’autre que d’un aller-retour en Syrie. Alors faut-il donner du crédit à la crainte qu’il inspire et l’incarcérer à titre préventif ? Mais dans ce cas, la décision est-elle juste ? Alma ne risque-t-elle pas de mettre un innocent en prison, voire de susciter par cette mesure de précaution sa radicalisation ?
Quand l’intime percute la conscience professionnelle
Le récit fait comprendre à quel point le métier de juge est un sacerdoce et combien il exige des nerfs solides pour faire face à la haine, à la violence, à la sournoiserie des prévenus. Appliquer la loi ne suffit pas. Ou plutôt, pour l’appliquer avec le plus de justesse possible, il faut décortiquer chaque situation et chercher dans les interrogatoires quelle est la part de vérité et quelle la part de manipulation.
Or, même pour les juges, il arrive que les affaires privées interfèrent dans cette quête d’objectivité. Car avant d’être un système technicien, l’institution judiciaire est faite d’hommes et de femmes qui, tout aussi dévoués qu’ils soient à leurs fonctions, sont influencés plus ou moins directement par leurs propres trajectoires.
Dans La Décision, l’intrigue mêle ainsi aux interrogatoires le récit intime de la juge, dont la crise existentielle vient brouiller le discernement : mère de trois enfants, en instance de divorce, elle tombe amoureuse de l’avocat du prévenu dont elle instruit le dossier. Elle a beau voir le danger et se jurer de ne pas laisser les sphères s’entremêler, peut-elle succomber à cette liaison sans compromettre son impartialité ?
Une écriture sobre au service d’une fiction brûlante d’actualité
Le sujet est brûlant, et l’autrice s’en empare avec une acuité pleine de finesse. Karine Tuil sonde l’âme humaine sans tomber dans l’écueil du manichéisme : elle ne cherche ni à l’assombrir ni à l’enjoliver, mais à en montrer la complexité. Son écriture est reconnaissable : précise, incisive, engagée. L’autrice évite l’emphase, préfère la sobriété au pathos, et cette quasi-austérité donne au roman sa densité émotionnelle. Chaque mot est pesé, et le « je » du personnage d’Alma nous plonge dans toute l’ambiguïté morale de la situation à laquelle elle se trouve confrontée.
Si l’on peut regretter dans le dénouement quelques grosses coïncidences qui font perdre au roman un peu de crédibilité, on ne peut qu’être saisi par l’actualité criante des thèmes qui sont abordés : le poids des responsabilités individuelles dans le système judiciaire ; l’équilibre périlleux entre justice et sécurité ; la place de l’intime dans les fonctions de pouvoir. Les enjeux sont réels, tout comme le contexte, mais ils ne sacrifient rien à la dimension haletante de l’écriture et de l’enquête. Au bout du compte, Karine Tuile montre sa capacité à inscrire une histoire individuelle dans un grand débat de société.
Âme sensible s’abstenir : le roman ne cherche pas à rassurer ; au contraire, il entend bien déranger.
« On se trompe sur les gens. D’eux, on ne sait rien, ou si peu. Mentent-ils ? Sont-ils sincères ? Mon métier m’a appris que l’homme n’est pas un bloc monolithique mais un être mouvant, opaque, et d’une extrême ambiguïté, qui peut à tout moment vous surprendre par sa monstruosité comme par son humanité. »
« Sur mon bureau, j’ai encadré cette phrase de Marie Curie: « Dans la vie, rien est à craindre, tout est à comprendre. » Mais parfois, on ne comprend rien. »