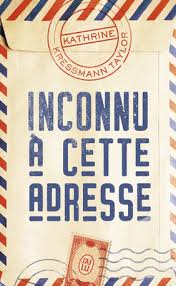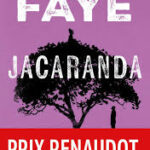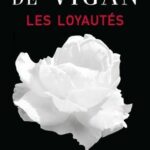Max Eisenstein et Martin Schulse sont deux amis de longue date, propriétaires d’une galerie d’art à San Francisco. Tous deux sont Allemands. Le premier est juif, l’autre non. Fin 1932, Martin rentre à Munich, en Allemagne. S’ouvre alors entre les deux une correspondance qui donnera au récit sa forme épistolaire.
Une nouvelle historique
Le contexte de cette nouvelle s’ancre dans cet entre-deux-guerres qui laisse l’Allemagne exsangue par le traité de Versailles et qui se tourne vers le national-socialisme, idéologie qui sous-tendra le parti nazi dont Hitler prendre la tête. En 1932, la correspondance entre les deux amis et associés est essentiellement commerciale. Mais petit à petit le ton change : à mesure que le régime nazi monte en puissance et que l’antisémitisme infuse la société allemande, la teneur des lettres se fait plus froide, distante. Max devient témoin incrédule et impuissant de la radicalisation de son ami qui progressivement adhère aux idées du Parti.
Un récit visionnaire
Inconnu à cette adresse a beau avoir été écrit et publié en 1938, bien avant que le monde prenne la pleine mesure de l’horreur nazie, il est d’une étonnante clairvoyance politique.
Ce n’est pas un pamphlet, pas un roman, mais une fable noire terriblement habile qui ne cherche jamais à démontrer, plutôt à traduire ce tragique glissement d’un homme cultivé, civilisé qui se laisse happer par un système totalitaire, jusqu’à en devenir complice.
Le récit est d’autant plus glaçant qu’il est parfaitement réaliste. Les lettres n’ont rien de spectaculaire ; les postures non plus. Mais elles annoncent avec une remarquable perspicacité cette page sombre de l’histoire à laquelle, en 1938, on refuse de croire.
Au moment de sa publication, Inconnu à cette adresse fait grand bruit dans les pays alliés, il apparaît comme une prémonition vertigineuse à laquelle on hésite néanmoins à donner vraiment du crédit tant l’histoire est absurde et choquante. Mais l’inconcevable survient, et a posteriori, l’ouvrage qui a sombré dans l’oubli au moment de la Seconde Guerre mondiale connait une nouvelle résonance au XXIe siècle. Cette fois, il n’est plus envisagé comme une terrible prémonition, mais comme le témoignage glaçant d’un embrigadement progressif et des conséquences dévastatrices qu’ont engendrés discours de haine et abandon de la pensée critique. On veut comprendre : est-ce par lâcheté ? Conviction ? Arrivisme ?
Une écriture minimaliste, d’une remarquable justesse littéraire
Tout le brio de cette nouvelle tient à sa forme concise qui ne cède rien à l’intensité émotionnelle. Le format est resserré, chaque mot compte, et la tension monte sans qu’on ne voie venir la rupture. L’écriture est lapidaire, voire assassine, et elle a cette immense capacité à suggérer l’indicible, à laisser le lecteur combler lui-même ce qui est suggéré dans les ellipses.
Le livre se lit en à peine une heure. Je l’ai refermé songeuse, partagée entre l’admiration littéraire et le choc de cette ironie cruelle sur laquelle il se termine.
Le coup de maître de l’autrice réside sans doute dans ce contraste saisissant entre l’extrême économie narrative et sa formidable puissance. En moins de cinquante pages, Kressmann Taylor donne une magistrale leçon de littérature, de politique, et d’humanité – ou de monstruosité ?
« Tu dis que nous persécutons les libéraux, que nous brûlons les livres. Tu devrais te réveiller : est-ce que le chirurgien qui enlève un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais ? Il taille dans le vif, sans états d’âme. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un acte brutal. Notre re-naissance l’est aussi. Mais quelle jubilation de pouvoir enfin redresser la tête ! Comment un rêveur comme toi pourrait-il comprendre la beauté dégainée ? »