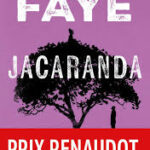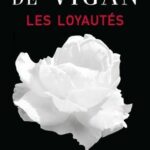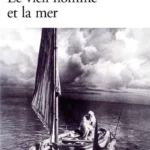La chaleur du Sud et sa misère ; l’espérance du Nord et sa grisaille. Dans Soleil amer¸ Lilia Hassaine explore l’ambivalence de l’exil, cet ailleurs empli d’espoirs et de désillusions. Le récit est découpé en trois périodes, de 1960 à 1980, au travers desquelles l’auteure aborde la question de l’intégration des populations algériennes dans la population française.
De l’Algérie à la France, récit d’une immigration
Le roman s’ouvre sur l’arrivée en région parisienne de Naja, jeune femme algérienne issue de la région des Aurès. Avec ses trois filles, elle vient rejoindre son mari, Saïd, ouvrier spécialisé. Celui-ci a été recruté pour sa vitalité et sa solide constitution, atouts d’une main-d’œuvre efficace et bon marché.
La famille vit dans un logement précaire au sein de ces grandes cités HLM toutes neuves qui incarnent l’utopie du vivre-ensemble du début des années 60, avec ses mélanges de populations, de cultures, de religions.
Peu de temps après son arrivée, Naja tombe enceinte. Mais les conditions de vie du couple ne leur permettent pas d’envisager sereinement cette naissance, d’autant qu’il n’y a pas un, mais deux bébés.
De l’espoir à la désillusion
Ce récit se lit comme une fresque familiale, doublée d’une chronique sociale. Si les deux bébés – deux garçons – deviennent le fil rouge de l’histoire puisqu’on les suit de l’enfance à l’adolescence, ce sont les femmes qui donnent des couleurs à l’ouvrage. Lilia Hassaine dépeint d’un trait économe leur résilience et leur rébellion, leur abnégation et le poids de l’amour maternel. Derrière l’apparente stabilité que parvient malgré tout à créer la famille, se tisse en effet une histoire faite de renoncements, de non-dits, de blessures. Car dans cette France des Trente Glorieuses, à mesure que les années passent, l’âge d’or des cités HLM périclite, les bâtiments se dégradent et leur abandon progressif va de pair avec l’usure des corps et la fatigue des âmes ; les banlieues deviennent sordides, les promesses d’avenir laissent place au désenchantement et à la mélancolie.
L’ambivalence de la double appartenance
L’écriture est sobre, marquée par des ellipses foisonnantes qui disent ce silence qui entoure l’immigration. Le silence du déracinement, le silence des mères soumises à leur mari et à leur sort, le silence d’une génération qui a préféré taire la douleur de l’exil pour offrir à ses enfants une vie meilleure. Pourtant jamais l’avenir ne semble se défaire de cette brume coriace qui plombe l’horizon, et petit à petit, les silences deviennent des failles où prennent racine la honte, la culpabilité, la révolte.
Les parents vacillent dans cette oscillation permanente entre le désir de rentrer au pays et le rêve de voir leurs enfants s’intégrer en France ; les enfants grandissent coincés entre deux mondes, deux identités qui les définissent autant qu’elles les enferment. Un héritage ambivalent, à travers lequel Lilia Hassaine interroge ce que signifie « être français » ou « être d’ailleurs ».
Une histoire de vie intime et universelle
Soleil amer dépasse le cadre familial pour raconter la France des Trente Glorieuses, des grands ensembles, des luttes ouvrières et des discriminations invisibles. En alternant les points de vue et les époques et en donnant une voix à ceux qu’on entend peu, Lilia Hassaine restitue une part de l’histoire nationale souvent occultée. Pour autant, son roman n’est jamais didactique : il reste d’abord un récit des sentiments, où les destins individuels éclairent les grandes questions collectives. Le style tantôt âpre, tantôt doux épouse les émotions des personnages et cette difficulté d’exister entre deux rives.
« Dans le regard des Français, il était “l’immigré” ; en Algérie, il s’en était aperçu au mariage de Maryam, il était aussi devenu “l’immigré”. On ne veut pas de celui qui arrive, on en veut à celui qui nous quitte. »